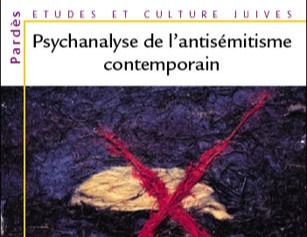Le Pays de l'Autre, par Jean-Pierre Winter
Par Jean-Pierre Winter | 10 décembre 2009
Ajouter
Partager
J’aime
Le psychanalyste Jean-Pierre Winter vient de nous quitter, à l'âge de 74 ans.
En 2009, il signait pour la revue Pardès un article sur le « Je est un autre » de Rimbaud. En s’appuyant sur la Genèse et sur son propre parcours d’exilé, il expliquait que notre identité se construit toujours dans un décalage entre soi et l’autre, un espace intérieur où l’inconscient nous échappe et nous façonne.
CES QUELQUES MOTS d’Arthur Rimbaud, « Je est un Autre », me concernent, à la façon dont la psychanalyse, comme théorie et pratique, le
confirme. J’expliquerai comment nous pouvons entendre cela aujourd’hui.
Toujours est-il que la question qui découle de cette proposition, ou plutôt
de ce constat, s’énonce forcément en termes géographiques, topologiques,
pour user des termes théoriques de l’analyse. Sans doute parce qu’il s’agit
d’un topos, d’un problème de géographie du psychisme si je puis dire,
cette conviction que « Je est un Autre » a-t-elle conduit Arthur Rimbaud
aux confins de l’Abbyssinie, à la recherche d’un lieu pour cet autre. Un
lieu que Proust, lui, cherchait plutôt dans le temps, et que Rimbaud va perdre dans l’espace.
PERSPECTIVE PSYCHANALYTIQUE
Ainsi la question est-elle celle du pays de l’Autre. Comme le disait
mon ami, aujourd’hui décédé, Serge Leclaire : « Le pays de l’Autre est
une expression qui, dans l’après-coup, me paraît parfaitement adéquate
pour parler du drame qui se trame à partir de l’épopée d’Abraham.»
Serge Leclaire continuait : « Le pays de l’Autre n’est la terre de personne.
Ni d’un lui, ni d’un toi, ni d’un moi. Il s’ouvre dans l’entre-deux de la
rencontre. Et rien ne peut en garantir les frontières, puisqu’il n’en a pas.
C’est un espace de libre échange des raisons et des passions. Un pays
de l’ailleurs, où fleurissent les orangers du désir et mûrissent les fruits
de l’amour. Objet de mille convoitises, il s’évanouit devant la moindre
tentative de mainmise. Il vit de ce qu’il est, terre de présent et de réel,
l’envers d’un mirage. »
Qu’est-ce qui fait pour nous office de mirage ? C’est la terre, identifiée
à la nature, la terre qui est à moi, à toi, pour toujours et de toute éternité,
passée, présente et future. La terre selon Heidegger, la terre heimlich.
Celle qui m’intéressera dans cette analyse est justement unheimlich,
c’est-à-dire «étrangement familière»; pas plus étrangère que familière,
ni plus familière qu’étrangère mais, comme le dit Betty Rojtman, à la
fois étrangère et familière. On pourrait traduire unheimlich, comme on
le fait en français habituellement, par «étrangèrement familière»; mais
tout autant, bien sûr, par « familièrement étrange ».
Si utile pour penser la question du transfert – lieu d’échange des
passions, des émotions et de la parole, relation de parole entre un sujet
qui ne se souvient pas de ce qu’il sait, comme nous pourrions définir
l’inconscient, et un tenant lieu d’Autre, le psychanalyste s’offrant provisoirement comme adresse – cet unheimlich qui constitue l’un des concepts
fondamentaux de Freud n’est pas, malgré les apparences, un oxymore. Car
nous allons l’entendre, à même le texte de la Genèse, c’est de l’étranger
que se fonde et s’articule le familier ; et c’est le familier qui me rend
l’autre étranger.
Le pays de l’Autre ou, plus précisément, les pays de l’Autre définissent
un entre-deux, un no man’s land fait de discours, de langues et de paroles.
Arrêtons-nous un moment sur la question de la nature, si prompte à nous
rassurer sur notre identité alors que le pays de l’Autre constitue, comme
le constate quiconque s’aventure dans l’art, dans la poésie ou dans une
analyse, une géographie intime entre cuir et chair, entre masculin et
féminin, mais surtout entre corps et mots. Entre corps et mots, sans
renoncer ni au corps ni aux mots. Ce pays de l’Autre, nous l’appelons, je
l’appelle l’inconscient. « L’Autre, disait Freud, c’est-à-dire l’autre pays. »
Un pays étrange, en vérité, où tout ne se joue que sur des effets de langage
qui sans cesse ont pour conséquence de me décentrer de moi-même. Un
pays aux coordonnées cartésiennes corrigées, puisque ce décentrement
fait que, là où je suis, je ne pense pas; alors que, dans le même temps,
là où je pense, je ne suis pas. C’est un lieu, l’inconscient, où je ne me
représente pas, où je ne me dis pas et où, in fine, je ne sais pas ce que je
dis. Dès lors, quiconque peut de son regard embrasser les limites du lieu
où il se tient s’imagine qu’il possède ce qu’il voit, et se rend aveugle au
lieu où il est sans pouvoir s’y représenter.
J’ai depuis longtemps été sensible à l’équivoque en hébreu entre îvrim
et îwrim, entre les passeurs et les aveugles. Aveugle au sens où Tirésias
est l’oracle aveugle, c’est-à-dire le voyant. Aveugle de s’en tenir à ce que Freud considérait comme les conditions premières à toute réduction de la violence et de la barbarie, à savoir l’interdit de la représentation. A-t-on suffisamment compris à quel point le respect de cet interdit fait de nous des étrangers sur n’importe quel sol, n’importe quel territoire ? Car l’image, c’est ce qui m’ancre dans la terre à la façon d’un mirage : je ne vois jamais que ce que j’imagine, le prenant pour un réel qui pourtant ne cesse de se dérober.
Permettez-moi de prolonger un peu cette introduction en disant que ce
que nous enseigne l’histoire d’Abraham du point de vue psychanalytique,
celui de l’inconscient, c’est que le pays de l’Autre, c’est le pays de l’autre
sexe. Pour chacun d’entre nous, oscillant entre Je et l’Autre, l’angoisse
menace de ne jamais savoir si je suis du côté où je m’identifie comme
sexué, homme ou femme ; si je suis ou non dans l’autre sexe.
UN PARCOURS BIOGRAPHIQUE
Je suis né à Paris, ma mère était née en Hongrie, qu’elle avait quittée
bébé, mon père venait lui aussi de Transylvanie, de Szatmarnemeti,
devenue roumaine après la guerre sous le nom de Satu Mare. Ils se sont
connus à Paris avec tous deux le statut de réfugiés. Par phobie ou par
ignorance, je ne l’ai jamais su, bien que nous soyons nés sur le sol français,
mes frères et moi avons gardé ce statut de réfugiés jusqu’à notre majorité.
Sur mon passeport bleu à doubles bandes noires, il était écrit, ce qui n’a
jamais cessé de m’intriguer : «Tous pays, sauf la Hongrie.» Mais cela
signifiait surtout que, quelle que soit ma destination, il me fallait un visa.
En fait, il m’était complètement égal de ne pas pouvoir aller en Hongrie,
mais je ne comprenais pas pourquoi on me l’interdisait. Je n’ai rien
fait aux Hongrois, et pourtant cela m’était interdit. Je ne le comprends
toujours pas aujourd’hui, même d’un point de vue strictement juridique.
Mes parents n’étaient pas des repris de justice, juste des Juifs fuyant les
persécutions. Alors, dans ma tête d’enfant, une question était formulée à
mon insu : «Vous pouvez aller vous faire persécuter n’importe où, mais
plus en Hongrie», est-ce cela que cela voulait dire? Entre-temps, juste
avant Mai 68, mes parents décidèrent d’émigrer en Israël avec mes deux
frères. Pour la première fois, ils avaient une nationalité et un passeport mais
c’était, là encore, un passeport qui leur fermait à l’époque les frontières
de la moitié de la planète. En principe, ils s’en moquaient, puisqu’ils
n’avaient pas les moyens de voyager.
Si je raconte tout cela, c’est pour préciser à partir de quoi je vais
soutenir mon propos; d’où je parle, comme on disait dans l’après-Mai
68 ; d’où je m’autorise, comme on dit encore aujourd’hui, afin de parler de
l’homme et de la Terre. Je suis donc sans terre, comme beaucoup d’entre
nous. Au fond, au quotidien, ça ne me soucie pas énormément. Mais cela
me pose problème quand je rencontre des gens qui me donnent, eux,
l’impression d’être solidement implantés dans le sol. On dirait que cela
leur procure une solidité psychique qu’on ne rencontre mythiquement que
chez les aristocrates, qui ont le « privilège » d’associer l’arbre de leur terre
ancestrale à leur arbre généalogique. Ces personnes, quand il m’arrive
d’en rencontrer, me donnent le sentiment de n’avoir jamais été chassés du
jardin d’Éden. Car, je tiens à le rappeler, le premier homme et la première
femme, cela commence par un exil. L’humanité débute dans l’exil, avec un
interdit violent : « Tous pays, sauf le Gan Eden. » Ce qui est navrant dans
cette histoire, c’est que cet exil est présenté comme la conséquence d’une
faute. Et c’est là que l’oreille du psychanalyste pointe : exilés parce qu’ils
ont fauté. Ainsi je me demandais, enfant, de quoi mes parents étaient-ils
coupables pour avoir dû s’exiler. Et je n’ai pas entendu, dans les propos
tenus ici, l’accouplement de cette dimension psychologique de l’exil et
de la culpabilité. J’étais en somme, toutes proportions gardées, comme
Abraham – en exil à cause d’une faute imputée à mon père. En outre,
il avait été en camp... donc ce qu’il avait commis, de mon point de vue
d’enfant, devait être énorme, un crime abominable, car non seulement il
avait été exilé mais on l’avait mis dans un camp plusieurs années durant. Ce
devait même être plus grave que la faute d’Adam et Ève qui, eux, avaient
échappé aux camps. Quoi d’étonnant que Caïn soit devenu, dans ces
conditions, un assassin ? Quand mes frères et moi nous disputions, enfants,
notre mère nous disait : «Arrêtez, Caïn et Abel!» Je n’ai jamais su qui
était l’un, qui était l’autre, on peut imaginer l’angoisse. Du coup, j’oscille
entre du presque rien, Abel, Hevel, la buée, et l’assassin – conçu avec Dieu
quand même, selon l’expression de sa mère Ève –, Caïn ! Ainsi y a-t-il faute
pour tout exilé, en tout cas dans l’inconscient, même si consciemment
il sait n’être coupable de rien. Ce qui n’est pas si simple car, justement,
tout n’est pas conscient. L’histoire d’Abraham elle-même n’échappe pas
à cette règle, nous allons le voir ; pas plus que celle de Moïse, qui s’exile
après avoir tué un Égyptien ; pas plus que celle des Hébreux, qui quittent
l’Égypte après la mort des premiers-nés des Égyptiens.
L’IMPURETÉ DE L’ORIGINE
Mais dans une autre histoire qui nous concerne, en tant qu’analyste, l’exilé par définition, par excellence devrais-je dire, c’est Œdipe,
doublement exilé. Une première fois par peur de fauter, donc avant
même d’avoir commis quelque faute que ce soit ; et une seconde fois
pour avoir fauté réellement, mais sans le savoir, en tuant son père et
en couchant avec sa mère. L’exil, en ce sens, est métaphore d’avoir
à renoncer à ces deux crimes ; ou mise en acte de ces renoncements,
qui sont ouverture au désir par séparation d’avec son père et sa mère.
Le Pentateuque le dit : « Lekh lekha mi-artzra oumi-moladetkha ». « Quitte
artzra – ta terre » ; mais quitte aussi « moladetkha – l’endroit où tu es né »
(Gn 12,1). Qu’est-ce que « l’endroit où tu es né » ? Au pied de la lettre,
c’est-à-dire psychanalytiquement, c’est la mère : quitte ta mère. En fait
il s’agit de rien moins que la simple répétition, suivie de sa mise en acte
à partir d’Abraham, au verset 24 du chapitre 2 de la Genèse, qui nous
enjoint de quitter : « C’est pourquoi l’homme abandonne son père et sa
mère, il s’unit à sa femme et ils deviennent une seule chair. »
C’est exactement ce que l’on va retrouver au moment où Isaac rencontre
Rebecca, moment où il est dit qu’il se console d’avoir renoncé à sa mère
en couchant avec Rebecca. C’est en ce sens que nous sommes tous des
exilés de ce lieu de naissance, exilés sans espoir de retour – avec même
un interdit sur le retour, raison pour laquelle les regrets et la nostalgie
sont toujours névrotiques. Apollinaire ne se trompait guère, écrivant dans
Alcools : « Regrets sur quoi l’enfer se fonde. Qu’un ciel d’oubli s’ouvre
à mes vœux. »
Venons-en au texte. Je suis frappé de ce que même ceux d’entre nous
qui s’attellent à le lire à la lettre font l’impasse sur un certain nombre de
choses qui pourtant sautent aux yeux si l’on abandonne tout préjugé. Il
y a en effet une équivalence posée dès le début de la saga d’Israël, et qui
ne l’était pas auparavant, entre la stérilité de la femme et la stérilité de
la terre. C’est à trois reprises la famine, sur trois générations, avec trois
femmes stériles, Sarah, Rebecca et Rachel. L’interrogation est tout de
même extraordinaire : pourquoi l’histoire d’Israël commence-t-elle avec
trois des quatre matriarches déclarées stériles ? D’où vient la nécessité de
poser d’emblée la question de la stérilité ? Et de la redoubler de la stérilité
de la terre ? Car, dans le scénario de la fuite en Égypte – repris dans les
Évangiles dans un contexte différent avec la fuite d’Élisabeth, la mère de
Jean-Baptiste, stérile – c’est ici la terre qui est stérile et impose à Abraham de descendre en Égypte. Quoi qu’il en soit, Abraham, comme Isaac et Jacob, se retrouve systématiquement dans un entre-deux, entre Canaan et l’Égypte ; et Abraham comme Jacob seront amenés à changer de nom.
Si nous nous concentrons, sans nous montrer des lecteurs pressés,
sur Abraham, à qui est faite la promesse, nous sommes confrontés en
remontant sa généalogie à ceci que j’appellerai « une impureté de toute
origine ». Que signifie là « impureté » ? Rien d’autre que hors la Loi. Et,
pour être plus précis, que signifie hors la Loi ? Cela signifie tout simplement incestueux. Alors qu’on est tellement attentif à ce qui se répète dans
la Torah, tenant compte du nombre de fois où l’on va employer le verbe
« voir » ou le verbe « regarder », je m’étonne que l’on soit si inattentif au
nombre de fois où l’on nous parle d’inceste dans l’histoire d’Abraham
et de la famille d’Abraham, dans la saga d’Abraham. Si c’était une fois,
au passage, on pourrait dire qu’il fallait bien en parler à un moment ou à
un autre. Mais quand cela revient plusieurs fois dans le même texte, puis
de nouveau à la génération d’après, avant de recommencer à la suivante
sous différentes formes, il y a tout de même quelque chose d’insistant qui
mérite qu’on s’y arrête. Je fais ici allusion au fait qu’Abraham, dans un
premier temps, épouse sa demi-sœur : sœur par son père, mais non par sa
mère. Aussi, quand il ment au pharaon en affirmant qu’il ne s’agit pas de
sa femme, mais de sa sœur, ce mensonge, en fait, n’en est pas vraiment
un. C’est un demi-mensonge, qu’Abraham va faire à deux reprises. Cela
nous est dit par le texte dans le récit de cet exil. Isaac réitère la chose,
sans même avoir l’excuse que Rebecca soit sa demi-sœur. Abraham, en
tout cas, a affaire à cela, à cette histoire de l’inceste qui est celle de Loth
avec ses filles.
Lorsque Abraham ment au pharaon, et que celui-ci s’aperçoit du
mauvais tour qui lui a été joué, il fait une chose tout à fait extraordinaire
du point de vue analytique, en répétant à Abraham cette injonction
entendue comme sidérante : « Lekh – prends ta femme et va. » Là est toute
la différence entre Dieu et le pharaon : Dieu dit « Lekh lekha » ; le pharaon
dit « Lekh ». Cela mérite d’être souligné, Abraham s’entend répéter par
deux fois qu’il doit partir. Par deux fois il lui dit quelque chose en quoi
Abraham se représente, fût-ce à son insu, oscillant entre «Lekh lekha»
et « Lekh ». En termes plus contemporains, « Lekh lekha » est le signifiant
qui représente Abraham comme sujet auprès du signifiant « Lekh ». Quand
Abraham devra se dégager de l’équivoque née de son alliance incestueuse,
il se trouvera entre deux signifiants, entre deux «Lekh» : l’un, «Lekh
lekha » ; et l’autre, « Lekh ». Je dirais qu’il est, comme chacun d’entre nous, incapable de sortir de cette oscillation sans en passer par l’Autre. C’est le pharaon, l’Autre, qui le libère du lien incestueux en lui disant : «Voilà ta femme, ce n’est pas, ou plus, ta sœur. Prends-la et va. » Le pharaon, l’Autre, est celui qui détient le deuxième signifiant après « Lekh lekha » ; celui sans lequel Abraham ne peut devenir un sujet, sans lequel il ne lui sera pas donné de se subjectiver.
Dès lors qu’il est sujet, il se sépare de ce qui le lie encore à sa famille
d’origine, c’est-à-dire de son neveu Loth qui, du coup, à son insu et malgré
lui, prend à son corps défendant en charge la question de l’inceste. Car
cette histoire n’a pas fini d’avoir des effets. La question reste actuelle de
savoir comment on pourrait s’y prendre pour effacer l’origine impure
sans se débarrasser de l’Autre, de qui je tiens aussi mon statut en partie.
Et l’on voit alors qu’à peine Abraham confronté à la question de l’inceste
se pose à lui la question de savoir où il va habiter.
Le poète récemment décédé, Aimé Césaire, répondait à cette question :
« J’habite une blessure. » D’une certaine façon Abraham aurait pu dire
la même chose. Sa réponse était : « Mais tout le pays que tu vois, je te
le donnerai ainsi qu’à ta postérité pour toujours.» Notons que ce pays,
Abraham ne le choisit pas. Il lui échoit par défaut, en ce sens que celui
qui choisit est Loth. Cette histoire est celle qui lui est donnée en héritage.
Qu’est-ce qu’un héritage ? Un héritage, c’est d’abord une formulation.
Je vous en donne un exemple. Deux amis, appelons-les, l’un Moshé,
l’autre Aaron, sont liés de très longue date. Moshé sent qu’il va mourir
et appelle son ami Aaron : « Je vais mourir et je te laisse mon immense
fortune, je fais de toi mon exécuteur testamentaire. Ma seule exigence
est celle-ci, donne à ma femme ce que tu veux, et garde le reste.» Une
fois Moshé mort, Aaron prend dix mille shekels, les donne à la femme
de Moshé et garde le reste de l’immense fortune. Évidemment, la femme
proteste, mais il s’en tient au testament. Elle va alors voir le rabbin et
lui explique ce qui vient de se passer. Celui-ci convoque Aaron et lui
demande : «Que t’a dit Moshé, exactement? – Il m’a dit : «Donne-lui
ce que tu veux et garde le reste. » C’est ce que j’ai fait. – Non, tu n’as pas
bien compris, « donne-lui ce que tu veux », c’est-à-dire ce que tu veux
pour toi, et garde le reste. » Cette histoire afin d’illustrer qu’un testament
est affaire de parole, d’énonciation. Toute la question de l’héritage tient
à l’énoncé et à la façon dont il va être interprété.
Toujours est-il qu’Abraham n’est pas entièrement arraché à ce que
j’appellerai son origine biologique, à l’impureté de son origine. Ce qui
en fait l’impureté, comme pour tout ce qui est biologique, est hors la Loi. Abraham n’est pas encore complètement dans la Parole. Si l’on devait reprendre la question des épreuves d’Abraham, je dirais que ce sont autant d’épreuves de purification par rapport à l’origine. Il s’agit de se purifier de la tentation de toute fusion incestueuse, avec la terre comme avec la femme. Abraham n’en est pas tout à fait là, c’est pourquoi il a encore besoin de signes; il n’est pas complètement dans le registre du signifiant. D’où, à mon sens, la nécessité du sacrifice. Le sacrifice, quel qu’il soit, qui consiste à couper en deux, puis à confronter les demis, est le symbole par excellence.
Conclure une alliance c’est couper, c’est littéralement se couper de
son origine biologique ; nous en avons de nombreux exemples dans
cette histoire. Et puisque ce texte en vient à sa conclusion, j’ajouterai :
que la terre soit l’objet d’une promesse et voilà qu’elle devient un effet
de langage – un fait de langage. En italien, il existe un célèbre roman
d’Alessandro Manzoni, I promessi sposi, qui fait entendre que la promesse
peut être également du côté de l’épousé. On traduit cela en français par
«les fiancés»; mais une fiancée, c’est la femme promise. La promise
est dès lors soumise aux lois du langage, qui sont celles de la coupure
entre signifiant et signifié, entre la parole et l’objet. La terre n’est plus
la nature, et comme le dit si justement et si profondément Albert Cohen,
« le peuple juif est le peuple d’anti-nature ». Ce qui ne prête à malentendu
que si l’on confond la terre de la promesse et la terre comme matérialité
géographique.