
5 min de lecture
Le Juif de Kippour
Par Robert Sommer | 02 septembre 1963
Ajouter
Partager
J’aime
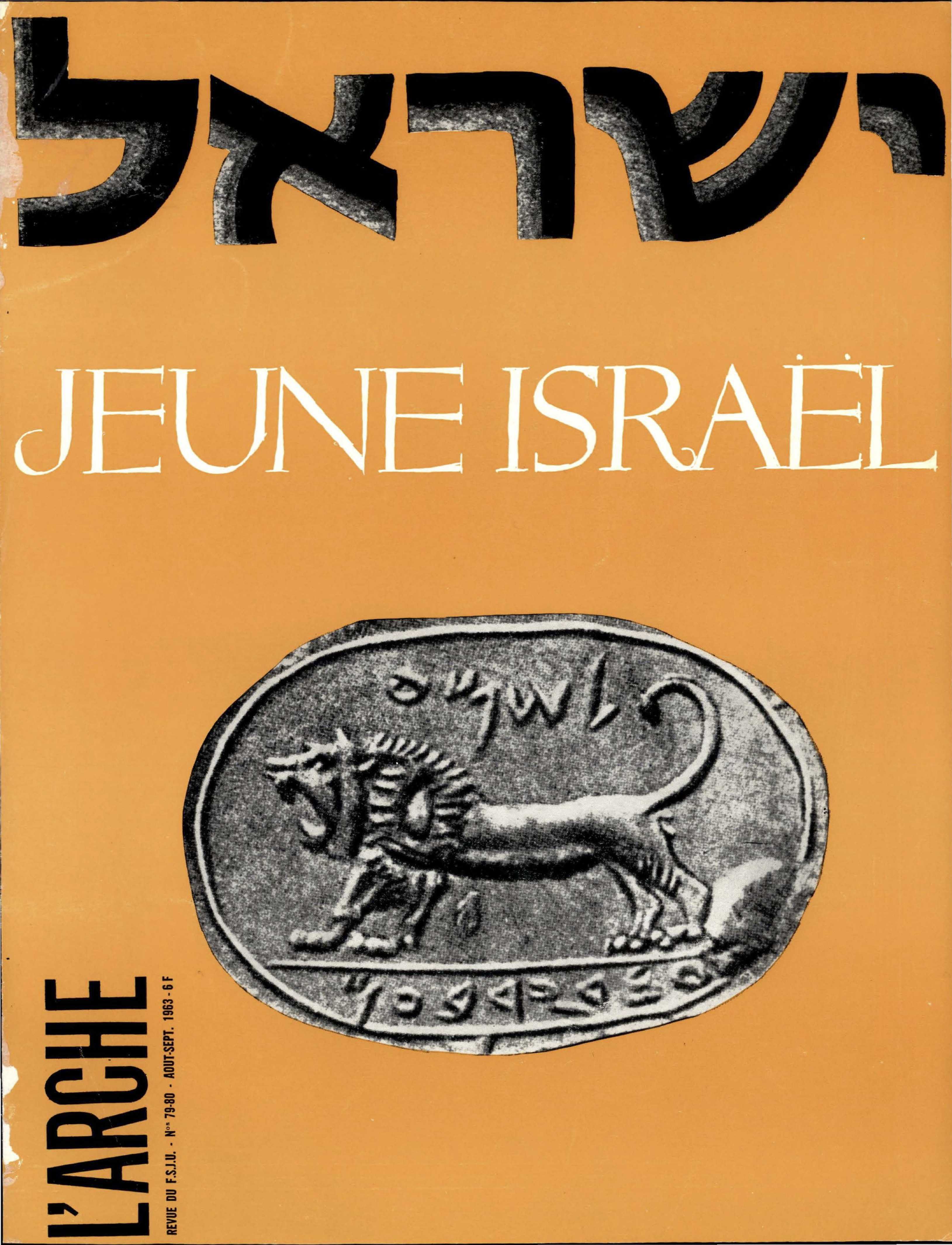
Revue de L'Arche - aout/septembre 1963
Un jour par an, les Synagogues ordinairement léthargiques débordent de fidèles. Les offices organisés un peu partout - au Cirque d'Hiver, à la Salle Pleyel, etc. - ne suffisent pas à la demande. Cette ferveur à éclipse de Tichri, si vite retombée, Robert Sommer l'analyse d'une plume acide, dessinant un personnage absurde, déroutant, mystérieux : le Juif de Kippour... que nous sommes tous, peu ou prou.

L'ENTRÉE DU TEMPLE DE LA VICTOIRE : Autant de monde qu'au Vél'd'Hiv' pour la finale de la Coupe de France...
On croit en Dieu ou on n'y croit pas. Si l'on n'y croit pas, aller participer à un office dans une synagogue est dénué de sens ; si l'on y croit, le judaïsme nous prescrit de prier trois fois par jour. Dans un cas comme dans l'autre, venir au temple un jour par an paraît une idée absurde.
Or il y a des milliers d'hommes qui viennent à Kippour et ne reviennent guère avant le Kippour suivant. Qui donc sont ces gens, quelle est leur mentalité ? Ont-ils tort ou raison ?
Il faut d'abord dire que la logique n'est pas au monde la chose la plus répandue. On peut aimer sa femme et la tromper, savoir que le tabac vous est nocif et se laisser aller à des écarts de régime ; on peut aussi, pendant que Moïse est sur le Mont Sinaï, demander à Aaron de vous fabriquer un veau d'or. Les Juifs ont - ou, sous prétexte que leurs ancêtres l'avaient, croient avoir - avec le Seigneur une telle intimité qu'ils le considèrent un peu comme un copain ; et chacun sait qu'un copain ne se formalise pas si, pendant un certain temps, on ne lui donne pas de nouvelles.
TYPOLOGIE DU « JUDAEUS KIPPOURENSIS ».
Il y a plusieurs types du judaeus kippourensis : celui qui vient pour accompagner sa vieille maman dont il ne partage pas les idées religieuses (il les nomme : superstitions) mais à laquelle il ne veut pas faire trop de peine, il l'a déjà suffisamment contrariée en épousant Mlle Dupont.
Celui qui vient en souvenir de ses parents décédés. Il pense - vaguement - que ça peut leur faire plaisir dans l'au-delà, s'il y a un au-delà, ce dont il doute. Celui qui, tel Pascal, parie. On paie bien une assurance contre l'incendie, pourquoi ne viendrait-on pas à la synagogue une heure par an ? Celui qui de bonne foi est convaincu que sa présence, assortie d'un petit don aux pauvres, lui assurera à la fois la rémission de ses fautes passées et l'absolution pour les péchés à venir. Celui qui a plaisir à rencontrer ses amis, à être vu par eux en un tel lieu en un tel jour, à entendre des airs traditionnels. Et peut-être aussi le masochiste qui sait que le rabbin va, du haut de la chaire, lui faire des reproches. Théoriquement, on pourrait supposer que la clientèle de Kippour comprend deux catégories : ceux qui viennent encore (et jadis venaient plus souvent) et ceux pour lesquels ce jour va constituer un point de départ vers un judaïsme plus fervent (s'il y a, bon an mal an, autant de gens au Vel d'Hiv pour la finale de la Coupe de France, certains n'étaient pas venus l'an passé et d'autres ne reviendront pas l'an prochain). Mais chacun sait qu'ici c'est différent. Fidèle depuis plus d'un demi-siècle, je puis vous dire que déjà avant la guerre de 1914 il y avait à Kippour à Paris des oratoires temporaires ; si, depuis ce temps, la population de Salonique et de Lodz, de Sfax et de Sidi Bel Abbès est venue sans que les murs de la Victoire aient éclaté, c'est que l'immense majorité des petits-fils des fidèles de 1914 a cessé de venir MEME A KIPPOUR. Chacun connaît la phrase finale de la dernière oraison funèbre de Bossuet : « ... les restes d'une voix qui tombe et d'une ardeur qui s'éteint ». La venue de quelques dizaines de milliers d'hommes au jour de Kippour et leur kaddisch ne constituent-elles que les restes d'une voix qui tombe et d'une ardeur qui s'éteint ou, au contraire, pouvons-nous honnêtement déceler des signes de réveil ?
A PARIS 60 % DES JUIFS NE METTENT JAMAIS LES PIEDS DANS UNE SALLE DE PRIÈRES.
Répondons avec objectivité et, par exemple, ne disons pas que tout ira mieux demain grâce à... etc. Laissons aux prophètes ce demain que chacun imagine au gré de ses souhaits et bornons-nous au présent. Vous qui me lisez en ce moment, interrogez vingt hommes le samedi 28 septembre et posez-leur les trois questions suivantes :
1- Votre père (ou : votre grand-père) venait-il à la synagogue moins fréquemment que vous ?
2- Puisqu'aujourd'hui vous êtes présent, avez-vous pris la solide résolution de venir cette année plus souvent que l'an passé ?
3- Agissez-vous pour que vos enfants viennent ici plus fréquemment que vous ?
2- Puisqu'aujourd'hui vous êtes présent, avez-vous pris la solide résolution de venir cette année plus souvent que l'an passé ?
3- Agissez-vous pour que vos enfants viennent ici plus fréquemment que vous ?
Je crains qu'à ces 3 questions posées à 20 personnes vous n'obteniez au moins cinquante : non. Si j'ai tort, écrivez-moi (aux bons soins de l'Arche) au lendemain de Kippour, non pas pour me citer des textes bibliques sur l'éternité du judaïsme (je les ai déjà lus) mais pour m'indiquer avec précision combien de Oui vous avez recueillis. Je m'engage alors à récrire dans le prochain numéro de l'Arche pour dire « j'avais tort ».
Il faut avoir le courage de reconnaître que la majorité de ceux qu'on appelle : juifs, ne vient pas à la synagogue, même plus le jour de Kippour. À Paris, en 1962, 8.075 hommes ont cotisé au F.S.J.U. En imaginant que chacun d'eux ait une femme et deux enfants, cela ferait 30.000 à 35.000 personnes. Ajoutons-y un nombre au moins égal de gens qui n'ont rien voulu donner (ou qu'on n'a pas trouvés) et autant qui sont trop pauvres - sinon même assistés - pour verser quoi que ce soit. On arriverait ainsi à une centaine de milliers d'âmes, chiffre considérablement inférieur à ceux qu'on proclame de tous côtés. Si j'en crois le dernier numéro de l'Arche, il y a en France 200.000 rapatriés d'Algérie, et à la dernière Assemblée générale du F.S.J.U. l'un des dirigeants les plus qualifiés a indiqué que le judaïsme français constituait une communauté de 500.000 personnes. Or, à Paris où se trouve réuni le plus grand nombre, combien sont venus à Kippour ? Le temple de la Victoire contient 1.800 places, Nazareth 1.200, Buffault 800. Ajoutez ceux qui sont restés debout dans les couloirs ou les péristyles, comptez 2.000 personnes à la Salle Pleyel et autant au Cirque d'Hiver, 500 par ci, 1.000 par là, additionnez les oratoires, les arrière-boutiques et le Concert Pacra, vous arriverez peut-être à 30.000, à 40.000 si vous êtes presbyte, et vous serez obligé d'avouer que la majorité n'est pas venue. De ceux qui sont venus, combien ont observé les règles religieuses du Kippour et, par exemple, n'ont pas utilisé leur voiture ? Combien possédaient un livre de prières, un talit, combien sont restés toute la journée, combien ont fermé leur magasin, combien ont emmené leurs enfants ? En cette France de 1963 dont tous les démographes nous disent que l'âge moyen est en baisse constante, constatez, ami qui me lisez en ce moment, constatez en regardant autour de vous à la synagogue le 28 septembre le petit nombre de jeunes par rapport aux adultes et aux vieillards.
UNE HEURE DANS TOUTE L'ANNÉE
Ce juif de Kippour, comment le séduire afin qu'il revienne avant le Kippour suivant ? Dans la plupart des cas on ne connaîtra ni son nom ni son adresse. Nos trésoriers souhaitent - peut-on leur donner tort ? - qu'une partie de l'office soit employée à emplir les caisses ; le rituel, même abrégé, est long et beaucoup sont venus pour entendre les airs traditionnels. Supprimer le service des morts ? Vous n'y pensez pas : combien ne sont venus que pour entendre rappeler le nom de leurs parents ! Alors que reste-t-il au rabbin pour qu'il se fasse entendre ! Une heure, pas davantage, une heure dans toute la journée, une heure dans toute l'année... Il a devant lui des gens qui n'ont pas mangé et c'est le cas ou jamais de dire : ventre affamé n'a pas d'oreilles. Ces hommes, ces femmes, il ne les connaît pas, il ignore leur niveau intellectuel ; savent-ils seulement un mot d'hébreu ? Parlera-t-il du chabbat, du sabbat, du chavess ou du chabbos ? Dans 3 cas sur 4 il risquera de n'être même pas compris. Déjà, d'un point de vue technique, l'organisation d'offices à Kippour constitue pour nos administrations cultuelles un problème comparable à celui de la quadrature du cercle : comment pour un seul jour par an trouver et aménager des locaux, recruter des officiants ? Si n'importe qui est capable de vendre du muguet le 1er mai ou du buis le jour des Rameaux, peu d'hommes savent chanter le kol nidré, bien moins encore sont dignes de le chanter. Mais, à supposer que, par un coup de baguette magique, soient résolues les questions matérielles, l'aspect religieux subsisterait et l'interrogation demeurerait sans réponse : quelle est donc la psychologie de ces « juifs de Kippour » ? Sont-ce des malins qui croient duper le Bon Dieu, tels ces hommes qui écrivent à leur vieille maman : « Certes, depuis un an je ne t'ai pas écrit ni ne suis venu te voir, mais j'ai constamment pensé à toi » ? Ou de braves types, si préoccupés par leur boutique le jour et leur télé le soir qu'ils ont, sans le faire exprès, oublié leur judaïsme ! Des hommes qui verraient avec indifférence leurs enfants sortir de la communauté ou d'autres qui s'imaginent qu'on peut rester juifs sans le moindre effort ! Ils savent bien qu'on ne peut conserver sa fortune qu'en travaillant, sa santé qu'en la ménageant, que le fils d'un virtuose ou d'un pugiliste ne sera pas pianiste ou boxeur en s'exerçant seulement un jour par an. Dès lors on en arrive à se poser la question : ces juifs de Kippour, sont-ce des hommes de bonne foi ?







